 |
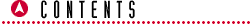 | ||||
 | |||||
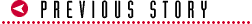 | |||||
 | |||||
par George Elliot Clarke
Il y a plusieurs étés, VIA Rail a offert une alléchante baisse de 50 pour cent sur ses tarifs aux étrangers visitant le Canada, mais ne l'a pas annoncée au Canada, de peur que cela n'antagonise les Canadiens dont les impôts subventionnent la société d'État. J'ai entendu parler de cette annonce alors que j'achetais un billet à la gare de Kingston (Ontario). L'agent m'a demandé furtivement mon passeport. Interloqué, je lui répondis «Qu'avez-vous besoin de mon passeport?» C'est alors qu'elle m'a appris le rabais consenti aux étrangers, en me précisant que mon «accent américain» m'avait trahi comme voyageur admissible. Je lui répliquai alors (comme le dit si bien l'annonce de la bière très blanche), «JE SUIS CANADIEN». Mais il n'a jamais été simple d'être Noir au Canada. Mon ascendance remonte très loin dans ce pays. Le père de mon père était antillais, mais le père de sa mère était arrivé en Nouvelle-Écosse en provenance de Virginie en 1898. Les ancêtres de ma mère, des esclaves libérés par les forces britanniques durant la Guerre de 1812, originaires de Chesapeake Bay vinrent s'installer en Nouvelle-Écosse en 1813. Je suis né, ai été élevé et éduqué en Nouvelle-Écosse. Je suis allé à Expo '67, ai chanté aux côtés de Ian and Sylvia et du Great Speckled Bird, et j'aurais tant voulu que Robert Stanfield remporte les élections en 1972. Soit je suis Canadien, soit le mot ne signifie rien. À bien y réfléchir, l'incident de VIA Rail n'avait rien à voir avec mon accent. Étant donné que la couleur de ma peau me distingue de la plupart des autres Canadiens, presque tout le monde présume que je viens «d'ailleurs». Lorsque quelqu'un me demande de quelle île je suis originaire, je lui réponds : «de l'île du Cap-Breton». En outre, les Canadiens sont d'une ignorance crasse sur l'histoire des Afro-Canadiens. Par exemple, un sondage de l'Association canadienne des libertés civiles réalisé en 1995 a révélé que 83 pour cent des Canadiens ignoraient que l'esclavage existait au Canada avant la Confédération.
Une étude réalisée à McGill et publiée cette année fournit les données démographiques les plus récentes sur la communauté noire du Canada et contient quelques révélations assez surprenantes. Même si je préfère l'expression Canadien d'origine africaine ou Afro-Canadien (car elle saisit bien l'expérience collective des Noirs originaires des États-Unis, d'Afrique et des Caraïbes), les auteurs ont cherché à comprendre «l'expérience noire» et la situation des Noirs dans la société canadienne. Diversity, Mobility and Change: The Dynamics of Black Communities in Canada a été rédigé par James Torczyner, professeur de service social à McGill, avec ses collègues Wally Boxhill, Crystal Mulder et Carl James. Ce rapport est une réponse à l'une des conséquences de la diversité afro-canadienne : le fait que près de la moitié d'entre nous ne s'identifient pas comme «Noirs» sur les documents censitaires canadiens. À vrai dire, 43 pour cent des personnes d'origine africaine qui ont participé au recensement de 1991 se sont déclarés Français ou Britanniques ou originaires de la Barbade, d'Éthiopie, du Ghana, d'Haïti, de Somalie, de la Jamaïque, de Trinidad et Tobaggo, etc., ce qui a entraîné une sérieuse sous-estimation du nombre de Canadiens d'origine africaine. Wally Boxhill, ancien employé de Statistique Canada, a remanié les chiffres pour y inclure les groupes ci-dessus comme Noirs canadiens. Cela signifie qu'en 1991, il y avait 504 290 Noirs au Canada et non pas 366 625 comme on l'avait pensé auparavant. Ces chiffres ne sont pas sans conséquences, mais avant que je n'aborde celles-ci, j'aimerais démêler une question qui semble avoir échappé aux compilateurs de l'étude, à savoir la raison pour laquelle un si grand nombre d'Afro-Canadiens ne s'identifient pas comme «Noirs». Comme Boxhill nous le dit dans sa très jolie prose, «près de la moitié des répondants nés en Haïti qui étaient de toute évidence noirs ont déclaré qu'ils étaient français. Un pourcentage aussi élevé de personnes nées en Jamaïque ont déclaré qu'elles étaient britanniques». Ces déclarations volontaires ne sont ni étonnantes ni inquiétantes, si nous comprenons que l'anti-africanisme, ce construit social qui divise les êtres humains en «Noirs» et «Blancs» (aux États-Unis et au Canada) n'est pas une source vive d'identité en Haïti ou en Jamaïque, les deux pays qui ont envoyé le plus grand nombre d'immigrants d'origine africaine au Canada ces 30 dernières années. (Torczyner prétend que 44,2 pour cent de toutes les personnes noires au Canada ont immigré depuis 20 ans). Comme le dit de manière si désopilante Dany Laferrière, cet écrivain du Québec dans sa satire de 1985, Comment faire l'amour avec un Nègre sans se fatiguer, ce n'est que sur le continent nord-américain qu'un Haïtien devient «noir», ou est censé souscrire instantanément à l'antagonisme blanc-noir qui ronge la majorité blanche (et les Blancs qui croient en la suprématie de leur race) aux États-Unis et au Canada. Dans les pays à majorité noire, les divisions sociales s'articulent autour des classes plutôt que des races (même si le «colorisme» qui est la discrimination exercée par les Noirs à peau claire contre les Noirs à peau plus foncée, est un véritable problème). En 1973, l'écrivain afro-canadien né à la Barbade, Austin Clarke, a décrit «l'écrivain antillais» comme «un homme issu d'une société ostensiblement exempte des pires pathologies du racisme, un homme issu d'une société dans laquelle le nationalisme noir a dû être importé par les Noirs américains...» Ce commentaire de Clarke souligne l'étrangeté des construits Blancs-c. Noirs pour de nombreux émigrés des Caraïbes. (Je n'oublierai jamais le chaos qui est survenu lorsque le député péquiste, Jean Alfred, d'origine haïtienne a déclaré devant la coalition nationale noire du Canada aujourd'hui défunte à Toronto en mai 1979 qu'il avait plus à coeur la libération du Québec que «l'unité noire nationale». La communauté noire estimait que ses besoins devaient l'emporter sur tous les autres.)
Par ailleurs, une fois que les immigrants noirs sont installés depuis assez longtemps au Canada, ils commencent à se heurter aux barrières que les suprématistes blancs érigent contre la réussite des Noirs dans cette société, obstacles que les Afro-Canadiens autochtones comprennent intimement. Un de mes amis noirs universitaires né à Trinidad m'a raconté récemment que lors d'une cérémonie où il célébrait un succès récent avec plusieurs de ses collègues canadiens de race blanche, l'un lui a dit après avoir avalé quelques verres : «et bien David, peut-être as-tu obtenu une subvention, mais moi je suis toujours blanc». En quoi le fait qu'autant de Noirs s'identifient avec leur lieu d'origine plutôt qu'avec leur couleur affecte-t-il le Canada? J'anticipe un rapprochement en vertu duquel les Afro-Canadiens immigrants qui s'identifient à leur patrie ont une affinité avec les Noirs nés au Canada et échangent avec eux des stratégies de résistance au racisme, le dénominateur commun de l'expérience des Noirs. Parmi ces stratégies, mentionnons les manifestations bruyantes contre les injustices et quelques tentatives d'organisation pour réduire l'incidence de la pauvreté et de l'analphabétisme. La communauté noire canadienne qui représente à peine 2 pour cent de la population aura plus de difficulté à se solidariser que les Afro-Américains qui représentent 13 pour cent de la population des États-Unis. Au Canada, le nombre croissant de Noirs de la deuxième génération ont plus de points en commun avec les expériences des Afro-Canadiens autochtones qu'avec une «patrie» antillaise de plus en plus lointaine. Deux écrivains qui évoquent merveilleusement cette sensibilité sont le Montréalais Robert Edison Sandiford, fils d'immigrants bajans dans son recueil de nouvelles Winter, Spring, Summer, Fall and Stories et Suzette Mayr de Calgary, fille d'immigrants allemands et caraïbes dans son roman Moon Honey où le protagoniste change de couleur pour passer de blanc à brun. Les Noirs du Canada sont essentiellement une communauté urbaine vivant à Montréal et Toronto. Boxhill signale qu'environ 240 940 Noirs vivent à Toronto, soit 47,8 pour cent de la population afro-canadienne; 101 890 Noirs vivent à Montréal, ce qui représente une autre tranche de 20,1 pour cent du total. Même si les Afro-Canadiens sont essentiellement citadins, il existe encore des enclaves rurales en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans le sud-ouest de l'Ontario ainsi qu'en Alberta et en Saskatchewan. Halifax et Vancouver (avec ses 15 385 habitants d'origine africaine, soit 3,1 pour cent de la population) sont des centres stratégiques à part entière. Incontestablement, la concentration des Noirs dans les deux plus grandes villes du pays leur confère un certain poids politique et économique. Il n'est pas étonnant dès lors que l'Ontario ait envoyé des Noirs, à commencer par Lincoln Alexander, à la Chambre des communes à chaque élection depuis 1968; en revanche, le premier Néo-Écossais noir (ou Afro-Canadien, pour employer un terme que je préfère) à siéger au Parlement, Gordon Earle, n'a été élu qu'au printemps dernier à Halifax, ville qui ne compte qu'à peine 2,1 pour cent de la population afro-canadienne (c'est-à-dire 10 560 personnes). Même si les Noirs ont réussi à faire élire l'un des leurs au parlement ontarien en 1963, Leonard Braithwaite, cette même prouesse ne se réalisera pas à l'assemblée législative de Nouvelle-Écosse avant 1993, lorsque Wayne Adams remporte la circonscription spéciale de Preston (la plus importante communauté entièrement noire du Canada). En plus d'illustrer la grande diversité de la communauté noire, l'analyse des données censitaires de Torczyner nous apprend quantité d'éléments sur la mobilité de cette population et étoffe nos connaissances sur la situation sociale des Afro-Canadiens. Ses statistiques offrent un tableau relativement rose de la situation des Noirs, en dépit des plaintes justifiées de cette communauté qui est l'objet de discrimination dans le domaine de l'emploi, de la scolarisation et du logement, et des accusations fondées de brutalité policière contre les hommes noirs. Cependant, les hommes noirs sont en meilleure posture au Canada qu'aux États-Unis sur le plan de l'éducation et de l'économie. Torczyner constate que «les hommes noirs obtiennent des résultats scolaires légèrement supérieurs à ceux de l'ensemble des hommes, des femmes ou des femmes noires au Canada». Cela s'explique sans doute par l'importance que les gouvernements des Caraïbes et d'Afrique attachent à l'éducation, surtout à l'instruction technique et scientifique, particulièrement pour les garçons. Si l'on recherche à la Bibliothèque nationale du Canada des oeuvres littéraires d'auteurs noirs, on découvre souvent à leur place des foules de thèses, essentiellement dans le domaine des sciences, d'étudiants de doctorat nés en Afrique. Ce phénomène est fort bien illustré par H. Nigel Thomas, auteur né à St-Vincent, dans son ouvrage Spirits in the Dark où le protagoniste de sexe masculin est fortement poussé à la réussite scolaire par ses homologues plus âgés dans la société. Environ 3,1 pour cent des hommes afro-canadiens détiennent une maîtrise, soit plus que la population canadienne dans son ensemble. Une autre explication réside dans la politique du Canada en matière d'immigration, qui au début n'admettait que les femmes des Caraïbes comme domestiques, avant d'admettre des hommes noirs, mais avec une préférence marquée pour les professionnels. (Le constat de Torczyner selon lequel il y a 20 000 femmes noires de plus que d'hommes noirs au Canada est attribuable à la politique d'immigration du gouvernement fédéral. Cela explique également partiellement le plus grand nombre de foyers monoparentaux dirigés par une femme chez les Afro-Canadiens que parmi les Canadiens dans leur ensemble). En outre, certains Africains qui viennent au Canada pour y faire leurs études décident d'y rester une fois en possession de leur diplôme. Par ailleurs, beaucoup des Haïtiens qui ont fui le régime de Duvalier dans les années 1960 et 1970 appartenaient à l'intelligentsia de leur pays. Lorsque Torczyner déclare que «les Noirs de Montréal ont un plus haut niveau d'instruction que ceux de Toronto et d'Halifax», il fait sans doute allusion à ce fait. De plus, les Africains qui ont fui l'apartheid en Afrique du Sud, les guerres civiles en Somalie et en Éthiopie et les dictatures en Ouganda, au Nigéria et ailleurs étaient souvent les citoyens les mieux instruits de leur pays. Le Canada a tout bonnement profité, de manière tout à fait délibérée, d'un exode des cerveaux à une époque. C'est ainsi qu'au Canada, un Afro-Canadien sur cinq est inscrit à l'université ou possède un baccalauréat, ce qui, à hauteur de 20 pour cent, soutient favorablement la comparaison avec la population canadienne en général.
De surcroît, malgré des indicateurs scolaires et professionnels positifs, et en dépit du fait que «les membres de la communauté noire ont moins de chances d'être tributaires de l'aide publique par l'entremise des paiements de transferts» que la population en général (10,6 pour cent contre 11,4 pour cent), près du tiers de tous les Afro-Canadiens, soit environ 31,5 pour cent de la population, vivaient en deçà du seuil de pauvreté en 1991, dont 40 pour cent de tous les enfants afro-canadiens. Ces taux sont alarmants. Ils indiquent clairement que tous les paliers de gouvernement et les établissements religieux doivent prendre des mesures de redressement, au même titre que les communautés afro-canadiennes proprement dites. L'appel que Torczyner lance dans sa conclusion aux «communautés pour qu'elles organisent des stratégies pour promouvoir l'accès aux acquis», afin d'assurer que les familles admissibles reçoivent les aides publiques auxquelles elles ont droit, est une façon de commencer. La suggestion de Torczyner selon laquelle les Afro-Canadiens doivent parvenir à un «consensus national noir» est toute aussi précieuse. Cela est plus facile à dire qu'à faire dans un pays qui a de la difficulté à s'entendre sur quoi que ce soit. Il n'en reste pas moins que son idée d'un «parlement des communautés noires au Canada» est fascinante, c'est bien le moins qu'on puisse dire. Diversity, Mobility & Change commence à répondre au Canada à un défi que Du Bois a lancé aux sociologues américains en 1898 pour qu'ils étudient les «problèmes des Nègres». Sa rhétorique (le langage du jour) est problématique, mais ses perceptions sont valables. Nous ne pourrons vraiment souder ensemble un peuple afro-canadien qu'en étudiant intensément sa situation, d'un océan à l'autre, sur cinq fuseaux horaires et demi, dans deux langues officielles et une centaine de groupes ethniques. Torczyner, Boxhill, James et Mulder ont fait une incursion remarquable dans ce sens. Ce qui ne veut pas dire que leur rapport soit parfait. J'aurais aimé par exemple que le bref aperçu de l'histoire des Afro-Canadiens fasse allusion à un plus grand nombre de textes, notamment à l'ouvrage de Robin W. Wink, The Blacks in Canada: A History (1971), en dépit de son aveuglément libéral américain à l'égard des différences appréciables entre le Canada et les États-Unis, et à celui de James Walker, The West Indians in Canada (1984). J'aurais également aimé que les chiffres et les dates dans l'essai historique affichent une plus grande exactitude. (Par exemple, 1 500 et non pas 2 500 Loyalistes noirs ont quitté la Nouvelle-Écosse pour le Sierra Leone en 1792). Dans son analyse des statistiques économiques des Noirs canadiens, Torczyner aurait pu faire allusion à l'étude d'Adrienne Shadd de 1987 sur les taux d'emploi et de rémunération des hommes noirs en Ontario et en Nouvelle-Écosse, ainsi qu'à l'étude menée par Agnes Calliste en 1995 sur les familles noires au Canada. En dehors de ces peccadilles et omissions, le groupe de McGill mérite nos applaudissements pour avoir donné un cliché relativement grand angulaire de la situation du Canada africain. George Elliott Clarke est professeur d'anglais et d'études canadiennes à l'Université Duke de Durham, en Caroline du Nord. Titre du rapport : Diversity, Mobility and Change: The Dynamics of Black Communities in Canada. Consortium de McGill pour l'ethnicité et la planification sociale stratégique, 1997, 20 $, personne-ressource : (514) 398-6696.
 | |||||

 Être Noir au Canada est une véritable expérience existentielle. Nous nous posons constamment des questions sur notre appartenance. Il ne s'agit pas tout bonnement de la «double conscience» que le grand intellectuel afro-américain W.E.B. Du Bois (prononcé «Do Boyce» aux États-Unis) a posé en principe au nom des Noirs américains, mais d'une «polyconscience». Car à l'instar de la couleur de notre peau qui peut prendre toutes sortes de nuances qui vont de l'ivoire au bleu indigo, nos patrimoines, nos allégeances ethniques, nos religions et nos langues sont éminemment variés. De fait, le Canada africain, dans sa merveilleuse diversité explicite, est un microcosme du Canada.
Être Noir au Canada est une véritable expérience existentielle. Nous nous posons constamment des questions sur notre appartenance. Il ne s'agit pas tout bonnement de la «double conscience» que le grand intellectuel afro-américain W.E.B. Du Bois (prononcé «Do Boyce» aux États-Unis) a posé en principe au nom des Noirs américains, mais d'une «polyconscience». Car à l'instar de la couleur de notre peau qui peut prendre toutes sortes de nuances qui vont de l'ivoire au bleu indigo, nos patrimoines, nos allégeances ethniques, nos religions et nos langues sont éminemment variés. De fait, le Canada africain, dans sa merveilleuse diversité explicite, est un microcosme du Canada.
 Tout ce que cela signifie est que la négritude canadienne est une identité complexe, truffée de contradictions et de fissures. Certes, le risque que l'on coure en parlant des «Noirs canadiens» est que l'on élide les vraies différences entre disons un Rastafari de Vancouver, une Sénégalaise d'Anjou et un Baptiste africain de Nouvelle-Écosse. L'étude de Torczyner effleure à peine ce problème. Torczyner reconnaît dans son texte très instructif que les diverses communautés noires canadiennes ont un agenda régional qui leur est propre». Et pourtant, il considère généralement l'expérience des immigrants noirs, surtout en Ontario et au Québec (où vivent 86,9 % de tous les «Noirs»), comme étant la norme, soutenant même que «l'immigration noire détermine une partie de l'identité collective des personnes noires au Canada». Or les populations d'origine africaine qui habitent les Maritimes, le Québec et le sud-ouest de l'Ontario depuis longtemps insistent jalousement pour retrouver leur histoire et s'en réjouir. Torczyner a beau dire qu'à «Halifax, avec sa longue histoire de colonisation noire, plus de neuf personnes sur dix appartenant aux communautés noires sont nées au Canada, et que l'influence caraïbe y est relativement faible», cette notion ne se retrouve pas dans toute l'étude.
Tout ce que cela signifie est que la négritude canadienne est une identité complexe, truffée de contradictions et de fissures. Certes, le risque que l'on coure en parlant des «Noirs canadiens» est que l'on élide les vraies différences entre disons un Rastafari de Vancouver, une Sénégalaise d'Anjou et un Baptiste africain de Nouvelle-Écosse. L'étude de Torczyner effleure à peine ce problème. Torczyner reconnaît dans son texte très instructif que les diverses communautés noires canadiennes ont un agenda régional qui leur est propre». Et pourtant, il considère généralement l'expérience des immigrants noirs, surtout en Ontario et au Québec (où vivent 86,9 % de tous les «Noirs»), comme étant la norme, soutenant même que «l'immigration noire détermine une partie de l'identité collective des personnes noires au Canada». Or les populations d'origine africaine qui habitent les Maritimes, le Québec et le sud-ouest de l'Ontario depuis longtemps insistent jalousement pour retrouver leur histoire et s'en réjouir. Torczyner a beau dire qu'à «Halifax, avec sa longue histoire de colonisation noire, plus de neuf personnes sur dix appartenant aux communautés noires sont nées au Canada, et que l'influence caraïbe y est relativement faible», cette notion ne se retrouve pas dans toute l'étude.
