|
Avant de créer la bourse d'études, de doter la chaire,
de construire l'immeuble ou de mettre sur pied le centre de prestige,
par exemple l'Institut d'études canadiennes de McGill, il faut
d'abord recueillir des fonds. Ainsi, un représentant de McGill
se charge de rencontrer la personne qui, d'après le Service de
développement, est susceptible de concrétiser le projet.
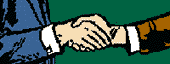 Selon la
tournure de la discussion, la personne qui formule la demande de fonds
peut réussir à convaincre son interlocuteur de lui remettre
un chèque dans les six à sept chiffres, ou encore, ternir
la réputation de l'Université auprès d'une personne
très influente. Inutile de dire qu'elle marche sur des oeufs. Selon la
tournure de la discussion, la personne qui formule la demande de fonds
peut réussir à convaincre son interlocuteur de lui remettre
un chèque dans les six à sept chiffres, ou encore, ternir
la réputation de l'Université auprès d'une personne
très influente. Inutile de dire qu'elle marche sur des oeufs.
« Il faut bien préparer le terrain avant de s'adresser au
donateur éventuel » a indiqué Derek Drummond, BArch'62,
vice-principal (Développement et relations avec les aciens étudiants).
« On ne décide pas comme ça, du jour au lendemain,
de frapper à la porte d'un bureau. On doit effectuer des recherches
approfondies au préalable et cultiver une relation avec le donateur
éventuel qui va bien au-delà de l'argent. »
« Nous demandons aux donateurs de faire partie des comités
afin de les sensibiliser aux priorités de McGill. Nous les invitons
également à participer aux activités qui se déroulent
à l'Université, par exemple à assister au dernier
opéra monté par la Faculté de musique. Si on se
contente d'arriver chez les gens à l'improviste, la main tendue,
ils vont tout simplement nous envoyer promener », d'ajouter M.
Drummond.
Le Service du développement et des relations avec les anciens
étudiants collabore avec un fort contingent de bénévoles,
dont certains font partie des groupes de diplômés actifs
dans le monde entier. En général, il s'agit d'hommes et
de femmes qui gardent un excellent souvenir de leur passage à
McGill et qui sont gagnés à la cause de l'enseignement
supérieur. De plus, comme ils sont en contact avec des donateurs
éventuels dans leur vie sociale et professionnelle, ils sont
souvent en mesure de mettre McGill sur la bonne piste et de lui indiquer
ce qui intéresse ces gens. «Ce genre de relations est capital
pour nous », a mentionné M. Drummond.
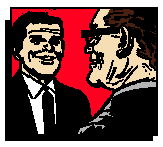 Des
agents de développement sont rattachés à chaque
faculté de l'Université et travaillent en étroite
collaboration avec les doyens en vue de dénicher des donateurs
éventuels. M. Drummond et son équipe sont épaulés
par un service de recherche qui passe en revue les rapports annuels,
les coupures de presse et d'autres documents susceptibles de nous fournir
des indices quant aux personnes cibles et à leurs intérêts.
« Nous n'allons pas trop en profondeur, la législation canadienne
sur la protection des renseignements personnels étant très
sévère », a déclaré M. Drummond. «
Aux États-Unis, la masse d'information que l'on peut obtenir
sur une personne dépasse l'imagination, de quoi faire dresser
les cheveux sur la tête à un Canadien. » Des
agents de développement sont rattachés à chaque
faculté de l'Université et travaillent en étroite
collaboration avec les doyens en vue de dénicher des donateurs
éventuels. M. Drummond et son équipe sont épaulés
par un service de recherche qui passe en revue les rapports annuels,
les coupures de presse et d'autres documents susceptibles de nous fournir
des indices quant aux personnes cibles et à leurs intérêts.
« Nous n'allons pas trop en profondeur, la législation canadienne
sur la protection des renseignements personnels étant très
sévère », a déclaré M. Drummond. «
Aux États-Unis, la masse d'information que l'on peut obtenir
sur une personne dépasse l'imagination, de quoi faire dresser
les cheveux sur la tête à un Canadien. »
Et si plusieurs
facultés lorgnent le même donateur? Supposons qu'un diplômé
en droit a fait fortune dans le monde du spectacle. Pourrait-il être
à la fois dans le collimateur de la faculté de droit et
de la faculté des arts? M. Drummond préside un comité
qui est précisément chargé de sortir de ce dilemme,
le cas échéant.
« Il est important que nous ayons la situation bien en main. Nous
tenons à éviter qu'un de nos doyens tombe sur un de ses
homologues d'une autre faculté dans une antichambre. Nous ne
voulons pas non plus que les donateurs aient l'impression d'être
harcelés ». Quelle faculté est l'heureuse élue?
« Celle qui est la mieux placée pour faire sauter la banque
».
Quant aux donateurs éventuels, ils s'attendent à ce qu'on
se renseigne à leur sujet avant de leur demander des fonds. «
Les gens qui me sollicitent doivent d'abord faire leurs devoirs »,
a affirmé Heather Reisman, directrice générale
d'Indigo Livres et Musique. « Certaines causes me tiennent vraiment
à cìur. Je suis beaucoup plus susceptible d'être réceptive
si la demande de fonds se rapporte à une de ces causes. »
Par exemple, Mme Reisman affectionne les projets qui mettent en relief
le rôle des femmes dans les professions. Ainsi, elle a récemment
doté une chaire de soins infirmiers à la University of
Toronto.
Vivienne Poy, BA'62, qui a réussi dans la mode et les cosmétiques
à la tête de Vivienne Poy Enterprises et qui vient d'être
nommée sénatrice, reconnaît que les collecteurs
de fonds devraient se donner la peine de mieux la connaître. «
Par exemple, j'apporte généralement une contribution aux
humanités parce que ces disciplines bénéficient
rarement du même soutien que la médecine et le génie.
»
Aux dires de M. Drummond, la personne qui aborde le donateur joue un
rôle capital. « Ce n'est pas tant à l'institution
qu'à la personne qui les sollicite que les gens font des dons.
Par extension, des donateurs restent sourds aux demandes de certaines
personnes. On doit donc les choisir avec soin. En règle générale,
ils ne donnent rien aux agents de développement. En fait, nous
sommes des timoniers; nous sommes là pour tenir le cap. »
« La demande de fonds a énormément de poids si elle
est formulée par une personne réputée pour sa grande
générosité », a soutenu Mme Reisman, «
par opposition à une personne dont le seul mérite est
d'occuper un poste dans une grande société. Brian Levitt
[le chef de la direction d'Imasco] constitue un bon exemple. On peut
difficilement trouver une personne aussi charitable. Si une personne
telle que lui fait la démarche, c'est inspirant. » David
Lank, spécialiste des services bancaires d'investissement, estime
que les universités confient souvent cette tâche à
la mauvaise personne. Il a recueilli des fonds pour un large éventail
de projets, de la réfection en profondeur et de l'agrandissement
du Musée McCord de Montréal (en tant que président
du conseil d'administration) à l'érection de la statue
de James McGill, qui est devenue indissociable du campus. « C'est
classique. Une personne est susceptible de faire un don très
important et tout le monde est au courant. Une personne de l'Université
tient à faire les démarches auprès de ce donateur
éventuel en raison du prestige qui rejaillira sur elle. Par contre,
il y a un bénévole qui est intimement lié au donateur.
La personne de l'Université a obtenu des fonds, mais le don aurait
été beaucoup plus élevé si la demande avait
été présentée par le bénévole.
»
On peut faire beaucoup avec un don d'un million de dollars; par exemple,
on peut créer une chaire d'enseignement. Cependant, l'Université
compte davantage sur la légion de donateurs qui apportent une
légère contribution chaque année. Selon Marie Giguère,
BCL'75, première vice-présidente, chef des services juridiques
et secrétaire de Molson Inc. et dirigeante du Fonds Alma Mater
de McGill, l'existence d'un réseau bien établi de groupes
de diplômés à l'échelle de l'Amérique
du Nord et, de plus en plus, de la planète, facilite énormément
la campagne de financement annuelle.
« Il est essentiel de faire naître un sentiment d'appartenance
à une communauté chez les diplômés de McGill
», a déclaré Mme Giguère. « Même
à des milliers de milles de distance, ils demeurent liés
à Montréal et à McGill. Il y a peu d'universités
au Canada qui peuvent compter sur une telle relation. C'est une des
grandes forces des universités américaines. » C'est
entre autres pour cette raison que les institutions américaines
surpassent nettement leurs homologues canadiennes au chapitre de la
collecte de fonds.
On pourrait même dire que cette différence ne date pas
d'hier. L'automne dernier, Lucien Bouchard, premier ministre du Québec,
assistait à l'inauguration de la bibliothèque de droit
Nahum Gelber, qui a été financée uniquement grâce
à des dons privés. Il a alors vanté la générosité
des diplômés de McGill et des donateurs et dit souhaiter
que les francophones apportent le même soutien à leurs
alma mater.
« Le don s'inscrit davantage dans une tradition chez les Anglo-Saxons
que chez les Français ou les Européens » a avancé
Mme Giguère. « Les francophones s'en remettaient à
l'Église ou à l'État. Les Anglo-Saxons se prenaient
un peu plus en charge. Mais les temps ont changé. J'ai grandi
dans une famille qui a toujours apporté son soutien à
des organismes et à des programmes. »
Purdy Crawford, président d'Imasco, participe depuis des années
aux activités de financement de McGill, de la Mount Allison University
et d'autres institutions sans but lucratif. Il a sollicité bien
des gens, mais n'aime pas se présenter seul devant un donateur.
« En général, j'invite les gens à faire un
don uniquement si un professeur ou un doyen, c'est-à-dire une
personne associée de près au projet, est à mes
côtés. Il y a des exceptions, mais je préfère
procéder de cette façon. »
|
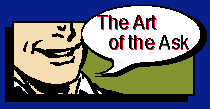
Before the scholarships, before the endowed chairs, before the
new buildings or the high-profile centres like the McGill Institute
for the study of Canada, comes the ask. Someone representing McGill
sits down with an individual the Development Office has identified
as the prospective donor who can make that endowed chair or scholarship
happen.
"There is a lot of groundwork that goes into it before the actual
ask," says Vice-Principal (Development and Alumni Relations) Derek
Drummond, BArch'62. "You don't just decide one day to turn up
in somebody's office. You do a lot of research beforehand and
you cultivate a relationship with them that involves much more
than just the money they might have to offer."
Drummond says that people are asked to sit on University committees,
for example, so that "they understand what the issues are at McGill."
Or they might be invited to the Faculty of Music's latest opera
production. "If you just knock on their door one day out of the
blue and hold out your hand, they'll tell you to bugger off."
Being prepared could mean the difference between success and
failure, says Heather Reisman, CEO of Indigo Books and Music.
"People who approach me ought to do their homework first. There
are certain causes that I feel a real attachment to and I'm much
more likely to be receptive if the ask is related to them."
While a million-dollar gift can fund a big-ticket item like an
academic chair, there is also an art to encouraging people to
give smaller gifts on a regular basis. Marie Giguère, BCL'75,
Chief Legal Officer and Secretary at Molson Inc., heads McGill's
Alma Mater Fund and says the University's impressive annual fundraising
efforts benefit enormously from a long-established network of
alumni chapters. "You have to build a sense of community and belonging
to McGill - that's essential. People who live thousands of miles
away still have a connection to McGill and to Montreal. We're
one of the few universities in Canada that does this," says Giguère.
Reeling from recent massive budget cuts, universities will have
to hone their "artistic" skills as they rely increasingly on private
donations, both large and small.
This article was first appeared in English in the McGill Reporter.
|
M. Crawford aide actuellement l'Institut neurologique de Montréal
à amasser des fonds pour son Centre de recherche sur les tumeurs
cérébrales. Le Dr David Kaplan, le directeur du centre,
accompagne souvent M. Crawford dans ses démarches. « Je
présente David au donateur éventuel et je le laisse parler
pendant 20 minutes. Le centre, c'est sa passion, et il arrive à
l'exprimer dans son exposé. Pour certains donateurs, il est essentiel
que le principal en personne vienne à leur rencontre. Ils croient
que, si le premier dirigeant se donne la peine de se déplacer,
c'est que l'enjeu est important. »
Pour Mme Poy, le choix de la personne qui doit présenter la
demande de fonds n'est pas si déterminant que cela. « Ça
ne m'influence pas du tout », a-t-elle précisé. «
L'important, c'est la cause. En partant, il faut également que
j'aie confiance en l'institution. »
Évidemment, il y a des membres du corps professoral qui ne veulent
pas participer aux activités de financement. « Certains
professeurs considèrent le Bureau de développement comme
le rebut de l'Université », a fait remarquer M. Lank. «
Ils devraient savoir que, sans les collecteurs de fonds et les bénévoles,
ils dépendraient exclusivement de l'État. En pareil cas,
s'ils voulaient une bourse pour un étudiant ou améliorer
leurs installations, ils pourraient toujours courir. »
M. Crawford se souvient avoir participé à une campagne
orchestrée par le pire président que l'on puisse imaginer.
« Il finissait toujours par agacer son interlocuteur. Sous d'autres
rapports, il jouait bien son rôle de président, mais il
était nerveux à l'idée de demander de l'argent.
Ça le mettait tout simplement mal à l'aise. » M.
Crawford a eu tôt fait de se faire accompagner par quelqu'un d'autre
dans ses démarches.
Selon Mme Giguère, il convient de rappeler aux gens les bienfaits
à long terme. « Nous devons les convaincre que, comme l'État
réduit constamment sa participation financière, ils se
doivent d'appuyer les universités pour le bien de la société,
tout particulièrement s'ils ont eu la chance de faire des études
universitaires. »
« Il n'appartient nullement au Bureau de développement
de déterminer comment l'argent recueilli sera utilisé
», a expliqué M. Drummond. « Les universitaires nous
indiquent le montant que nous devons amasser. Nous formulons nos demandes
en conséquence auprès des donateurs éventuels.
Nous accordons la priorité à l'aide financière
aux étudiants, à l'enseignement, à la recherche
et aux bibliothèques. Nous pouvons difficilement sortir de ce
cadre. »
« Le donateur a bien le droit de poser certaines conditions; après
tout, c'est son argent », a soutenu M. Lank. Il faut avant tout
s'assurer que ces conditions ne vont pas à l'encontre des objectifs
de l'Université. M. Lank sait que, dans au moins un cas, l'Université
a refusé la dotation d'une chaire parce qu'elle n'a pas pu s'entendre
avec le donateur sur le choix du titulaire de la chaire. « Dans
de telles situations, l'Université doit se désister; elle
imposera ainsi le respect. »
« À mon avis, le donateur ne devrait pas imposer de conditions
», a mentionné Mme Poy, qui a créé des bourses
d'études supérieures à la University of Toronto
et des bourses de début d'études pour la faculté
des arts de McGill. « Je n'oserais jamais. Je suis une chaude partisane
de la liberté des universitaires. » Elle croit cependant
que l'on est en droit de s'assurer que les dons contribuent à
la réalisation des objectifs décrits par l'université
lors de la demande de fonds. « Si je sens qu'il y a un problème,
je vais m'objecter immédiatement.»
De même, les universités ne doivent pas manquer d'informer
le donateur lorsque l'argent change de main. Mme Poy a expliqué
que McGill lui a toujours communiqué le nom des récipiendaires
des bourses de début d'études créées grâce
à ses dons. « L'Université me tient au courant. Si
on se contente de prendre mon argent sans se soucier de moi, ce sera
la fin de la relation. »
« L'information circule constamment; nous devons la ventiler en
fonction de chaque donateur, » a déclaré M. Drummond.
« Nous consacrons beaucoup plus de temps et d'argent au suivi pour
répondre aux attentes des donateurs. Nous devons être en
mesure de répondre à toutes les questions qui nous sont
posées. »
L'État a récemment sabré l'enveloppe budgétaire
de l'éducation, et les universités doivent se débattre
pour combler le manque à gagner. Si elles veulent survivre, elles
feraient mieux d'avoir des réponses en réserve.
|